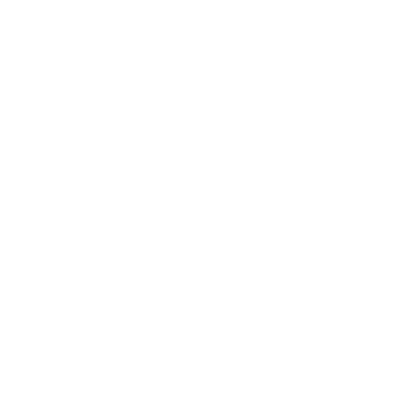En mai 2021, la deuxième étape de la résidence itinérante de Thomas Giraud le mène sur les bords de Loire, près d'Orléans, avec l'Association des Amis de Michèle Desbordes, dans les pas de l'écrivaine. Ciclic vous propose de découvrir ici le magnifique texte intitulé "Descendre la Loire" et à l'écoute la lecture qui s'est déroulée le 16 octobre 2021 à la médiathèque d'Orléans.
Au printemps 2021, l’auteur Thomas Giraud a parcouru la région Centre-Val de Loire, dans des lieux associés à quatre figures du patrimoine littéraire : le Musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine (18), le Musée Balzac – Château de Saché (37), la Maison-école du Grand Meaulnes et la Maison natale d’Alain-Fournier (18), ainsi que l'Association des amis de Michèle Desbordes (45). Chacune de ces courtes résidences a suscité l'écriture d'un texte, qui fera l'objet d'une restitution par l'auteur, dans chacun des lieux. Rendez-vous le 16 octobre à Orléans pour Descendre la Loire, autour de Michèle Desbordes, et le 17 octobre au Musée Balzac – Château de Saché (37) pour un temps de partage de son texte L'avis du couturier Jean, évocation de Pierre Ripert, sculpteur des personnages de La Comédie Humaine, et de son couturier... Ciclic vous dévoile chaque mercredi de ce mois de septembre un des quatre textes écrits par Thomas Giraud, suite à ses séjours littéraires. Un projet soutenu par le réseau Écrivains au Centre et Ciclic-Centre Val de Loire.
Descendre la Loire
Ce qui était indispensable, c’était d’habiter en haut, plus haut. Pas qu’il soit question d’être à l’endroit le plus élevé, mais seulement être au-dessus. Peu importe au-dessus de quoi à vrai dire, ni sur quoi : un rocher, une butte ronde, un coteau qui perd ses pierres, malingre, une petite falaise toute raide. Surplomber surtout, même légèrement, avec l’idée de voir au loin les champs, plus loin des arbres, le début des sombres forêts empaquetées de grillages de la Sologne, la seule idée pouvant prendre le pas sur le fait de voir vraiment. Que cette possibilité existe, même si ce n’est que certains jours et par certaines lumières.
Et en effet, la maison était posée sur sa petite hauteur, hauteur invisible depuis la rue et qui se donnait une fois qu’on entrait, le soleil dans le dos, par les fenêtres. De là, l’horizon offrait ses creux, une possibilité de voir plus bas, de cette façon. La maison vous avait plu immédiatement. Dès la première visite. Les mois d’attente faits de tracasseries administratives, notariales et bancaires furent pénibles comme elles le sont toujours. L’attente de pouvoir revenir dans cette maison devenait un calvaire, comme si chaque document supplémentaire que l’on vous réclamait retardait l’échéance de pouvoir être enveloppée. Vous aviez peur que la maison vous échappe.
De là, sur cette hauteur, on peut guetter ce qui arrive, il ne peut qu’y avoir des choses qui arrivent quand on peut guetter autant. Il suffisait d’attendre, il suffisait d’observer ce que les ciels ont à offrir, ce que les nuages s’amusent à faire, ce qu’est un arbre dont on voit à peine le tronc mais surtout la chevelure hirsute, ce que les oiseaux montrent, surtout leurs ventres gris, sombres ou blancs quand il s’agit des hirondelles qui nichent tout près. Voir loin pour voir, peut-être pas mieux, mais différemment. Avec toute cette vue, laisser de la place pour ressentir la nuit intérieure. Celle-ci s’était abritée en vous, sans retenue, avançait certainement à pas un peu trop lourds pour que vous ne puissiez pas être capable d’en identifier les étreintes obscures. Devant la fenêtre, même avec cela, vous souriez, comme si vous saviez qu’ici la maladie de la mort pouvait se vivre.
Ce qu’il fallait aussi, c’est d’habiter une maison que l’on a choisie, une maison dont on pourra dire aux parents, aux amis, au facteur peut-être, à soi-même surtout, que c’est vraiment la nôtre, que celles d’avant n’étaient que des préparations à celle-là. Cette maison devait arriver à ce moment-là de la vie. Après celle pratiquement adossée à un volcan et avec la mer qu’on voyait en bas qui faisait tout de même, avec tout ce bleu, une paix infinie, mais si loin de tout, de tous. Après les appartements de Paris entre le 13e et le 14e arrondissement et ceux en banlieue dont vous avez oublié parfois même jusqu’à l’adresse. Après la maison d’Andrésy qui était un entraînement à vivre à proximité d’un fleuve. Vous y fréquentiez la Seine, noueuse, verte, marron même, laquelle glissait pas loin. Un entraînement car la Seine coule mollement, indolente et lourde. Elle est trop souvent contenue, maitrisée par des barrages pour être industrieuse, pour être une voie, navigable, et presque plus un fleuve qui en imposerait à tous. Et fréquentation car c’était une relation lointaine. Impersonnelle. Des visites le week-end, toujours accompagnée. La Seine ou autre chose, au fond, ça ne comptait pas beaucoup.
Et ce n’est pas suffisant d’aimer une maison, de chérir le blond d’un parquet ou l’épaisseur datée d’un mur, d’admirer les proportions et le bruit que font le vent et les pluies sur les ardoises quand on est installée dans son lit. Il faut réussir à l’aimer longtemps et, pour cela, elle aussi, doit nous aimer. Il y a des maisons qui ne veulent pas de nous. On est réveillé en pleine nuit par des craquements que l’on ne comprend pas, on y a des migraines et des douleurs aux yeux, on a de la mélancolie et l’impression que l’on n’est pas seul. On se cogne beaucoup, le sol n’est jamais le même, plein de pièges et mêmes nos propres meubles nous regardent, interrogatifs, inquiets de ce qui se déroule ou au contraire de ce qui ne prend pas. On n’y fait pas grand-chose d’autre que de veiller à sa propre santé et on s’occupe de la poussière. C’est tout. Quelque chose s’est rompu, ou quelque chose n’a jamais été et une chose est sûre, on n’y est pas à sa place. Mais cette maison-là, rue Abbé Pasty à Baule, la vôtre, elle fait tout pour vous apaiser. Vous l’avez trouvée, elle vous a retenue. Vous y avez des connivences secrètes, des fenêtres bien placées pour regarder les mésanges, des marches qui prennent le soleil dès avril et sont à l’abri du vent où vous n’aimez rien tant que boire le thé dans ce service en porcelaine chinois que vous aviez ramené d’un voyage. Et il y a cette chose dont vous ne parlez à personne, cette odeur que l’air fait dans la maison. C’est frais comme les draps qui ont séché dehors, ou les fleurs que l’on vient de couper. Dans ce lieu, vous pouvez penser à autre chose, aux clartés des jours et aux ténèbres qui sont là, sous votre peau, la question de la maison est réglée et, en même temps, vous ne pensez qu’à elle, cette maison, ses douceurs, ce qu’elle ne dit pas et ce qu’il va falloir découvrir. Vous êtes impatiente de la retrouver, tous les jours, vérifier que l’effet se produit toujours, que votre cœur bat fort lorsque vous poussez la porte et que la lumière des fenêtres en face vous attrape le haut de la tête.
La maison est à la bonne distance de la Loire. On ne la voit pas. Elle est à deux cent mètres, guère plus, cachée par des rangées d’arbres, abritée dans le creux de son lit. On devine sa pulsation, sent que l’air y est plus frais, plus épais aussi que plus haut dans le village. Elle fait peu de bruit, c’est très léger. On n’entend que très rarement un fleuve, ses frottements. Ou seulement à certains endroits, sous les piles des ponts lorsqu’il se rebelle contre l’obstacle immobile ou quand le fleuve se jette. Ici, la Loire est calme, solennelle, large et tranquille. Elle est à son affaire, mange un peu la terre, accueille l’eau de pluie sans broncher, transporte lentement les embâcles, débris et atterrissements, flottants, sans crainte de se blesser, étire la végétation rivulaire, fabrique même quelques îles à ses heures perdues. Ce que vous entendez ce sont les bruits de ceux qui parfois sont sur la Loire : les mouettes qui remontent jusque là, les hérons, les canards ou de temps en temps quelques barques. Tout cela, en creux, vous dit que la Loire est là. Elle ne partira pas. Elle vous attend d’une certaine façon.
Ici, à Baule, en amont, ce n’est pas la mer. Elle n’a jamais été jusque-là. Pourtant on est déjà en territoire liquide même si cela se voit moins car la Loire ne prend pas toute la place. Mais elle fait ce qu’un fleuve doit faire quand on le laisse tranquille et, surtout, elle dit déjà deux ou trois choses de la mer : une impression de mouvement perpétuel, des mouettes et tout ce que l’on retrouvera dans la mer qui sera passé par ici : des bouts de bois, des bouteilles vides, des sacs plastiques. Où que l’on soit sur le trajet de la Loire, même loin, même ici où la mer est encore à 350 kilomètres, être près de la Loire c’est avoir avec soi le chemin pour rejoindre, d’abord, l’endroit où le sel et les marées la changent, la rendent maritime, et ensuite, plus loin encore, l’estuaire qui s’ouvre outrageusement, plein de souveraineté, c’est-à-dire au fond n’importe comment, avec autorité et despotisme, selon ses délices, où tout se mélange, fleuve, mer, poissons, sel, vase, sans queue ni tête mais où, en même temps, tout y est à une place incontestable.
La Loire c’est plus qu’une route pour trouver la mer, un peu mieux. La route ne nous aide pas, elle ne nous porte pas, il faut y faire rebondir nos pieds dessus, que les pneus d’une automobile soient entraînés par un moteur, ceux d’une bicyclette par l’énergie du corps. Il faut autre chose pour avancer alors que la Loire, elle, est prête à nous porter, nous balloter, nous endormir sans que l’on n’ait rien à faire, jusqu’à la mer, sans rechigner comme elle le ferait avec une feuille, une bûche, un débris. Tout finit par arriver, par terminer dans ce lit, dans ce grand lit de la mer.
Il y a ce rêve que vous avez fait. Un de ces rêves récurrents dont on ne sait jamais bien s’il nous constitue autant que la taille de nos jambes ou la couleur de nos yeux ou s’il est là pour nous rappeler les tourments et inquiétudes souterraines non résolues. Il est noté quelque part, à plusieurs reprises, dans des notes que vous ne reprendrez pas d’ailleurs, « un jour il y a longtemps, je fais ce rêve-là, de descendre le fleuve, je rêve que je descends le fleuve, que je n’en finis pas de le descendre ». Avec cette maison vous poursuivez le rêve. Vous êtes en haut, vous avez le soleil dans le dos, on l’a dit, vous avez le vent, vous avez l’élan. Comme dans ces jeux d’enfants, en haut d’une côte, où l’on se laisse aller, à bicyclette, sans pédaler, à fond de train, on se jette pour rejoindre quelque chose que l’on ne sait pas, dont on ne connaît pas la couleur, le noir, que l’on n’a pas encore déterminé à cet âge-là.
Cette maison, cette dernière maison, vous amène au plus près que vous puissiez être de la Loire. Au plus près mais sans la voir. Il est trop tôt pour la voir beaucoup. Vous la verrez beaucoup après. Une fois que tout sera fini, vous l’aurez beaucoup, vous serez à elle. Selon ce que vous avez demandé, après l’incinération, seront dispersées dans la Loire, des cendres. Vos cendres dans la Loire, descendues pour de vrai. Ce sera à Beaugency, déjà un tout petit peu en aval de Baule. Peut-être pour prendre un peu d’avance pour rejoindre la mer. Peut-être pour profiter du joyeux tumulte que la Loire fait devant cette pile du pont, rive droite. Là, ça secoue, là on se mélange vraiment, on se fond dans tout, dans l’eau dynamisée, dans ce qui déborde à cet endroit.
[Thomas Giraud, 2021]