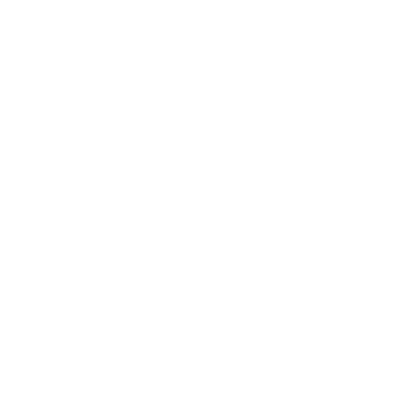En 2015, Ciclic Centre-Val de Loire et la librairie Les Temps Modernes vous proposaient un rendez-vous mensuel, autour de ce livre. Ce n'était encore, selon les mots de Tanguy Viel, qui venait lire une fois par mois ce qu'il venait tout juste d'écrire, qu'un "presque livre". Le voici aujourd'hui publié aux éditions de Minuit, revu, modifié, augmenté d'un chapitre inédit "Défense du négatif". C'est à cette occasion que Johan Faerber s'est entretenu avec l'auteur le jour même de la sortie d'Icebergs. Nous vous proposons de découvrir ici l'entretien publié sur Diacritik, partenaire de ce projet.
Indubitablement, Icebergs de Tanguy Viel, qui paraît aujourd’hui aux éditions de Minuit, s’impose comme un livre clef des années 10. Après la splendide Disparition de Jim Sullivan et le fulgurant Article 353 du code pénal, Tanguy Viel interroge ici l’écriture elle-même et enquête sur cette puissance qui tourne incessamment en lui, entre vide et mélancolie, et qui ne cesse de l’habiter entre deux romans. De Montaigne à Proust en passant par Paul Valéry et Aby Warburg, Tanguy Viel se promène et arpente les bibliothèques pour raconter comment l’écriture peut se cristalliser et enfin faire œuvre. En véritable Bartleby qui dévoilerait sa chambre interdite, Tanguy Viel livre ici l’autobiographie de son écriture. Essai ? Récit ? Roman critique qui interroge et relance sa propre pratique ? Autant de questions sur Icebergs que Diacritik ne pouvait manquer de poser à Tanguy Viel le temps d’un grand entretien.
Ma première question voudrait porter sur l’origine de votre très bel et fort essai Icebergs qui vient de paraître. À quelle occasion l’avez-vous écrit ? Je crois savoir qu’il a d’abord fait l’objet d’un feuilleton théorique à la librairie Les Temps modernes d’Orléans : pourriez-vous nous en préciser les circonstances exactes ?
 Je crois qu’il est surtout né d’une accumulation de pensées que je consignais depuis plusieurs années, de manière de plus en plus quotidienne et compulsive. Alors, comme ça commençait à déborder, j’ai senti qu’il fallait les mettre en forme avant qu’il ne soit trop tard, je veux dire, avant que la tâche soit trop lourde. J’en ai parlé à un ami qui s’occupe de résidences à CICLIC, l’agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en Centre-Val de Loire, et ensemble nous avons proposé à la librairie Les Temps modernes cette idée de présentation en feuilleton mensuel. C’était d’abord un moyen de m’obliger à rédiger, à mettre en ordre ces réflexions un peu tous azimuts sur l’écriture, la pensée, l’existence, etc. Et ça a marché.
Je crois qu’il est surtout né d’une accumulation de pensées que je consignais depuis plusieurs années, de manière de plus en plus quotidienne et compulsive. Alors, comme ça commençait à déborder, j’ai senti qu’il fallait les mettre en forme avant qu’il ne soit trop tard, je veux dire, avant que la tâche soit trop lourde. J’en ai parlé à un ami qui s’occupe de résidences à CICLIC, l’agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en Centre-Val de Loire, et ensemble nous avons proposé à la librairie Les Temps modernes cette idée de présentation en feuilleton mensuel. C’était d’abord un moyen de m’obliger à rédiger, à mettre en ordre ces réflexions un peu tous azimuts sur l’écriture, la pensée, l’existence, etc. Et ça a marché.
S’agissant toujours de la genèse d’Icebergs, son écriture est en partie intervenue, je crois, entre deux de vos romans, La Disparition de Jim Sullivan et Article 353 du code pénal. Pourquoi la parole davantage discursive sinon essayiste s’est-elle imposée à vous, entre deux romans ? S’agissait-il comme une nécessaire respiration de l’écriture à elle-même ? Est-ce que, de manière récurrente, vous ressentez toujours entre deux romans la nécessité d’en passer par une parole plus théorique d’une certaine manière ?
Je me demande si ce n’est pas le contraire : que je n’essaye pas d’interrompre plutôt mon continuum réflexif en écrivant un roman. Finalement la réflexion, c’est le fond sur lequel tout s’inscrit. Mais on ne peut vivre éternellement dans son propre fond : c’est un confort trop autarcique, trop flottant, et qui finit par se retourner contre vous, en tout cas vous insatisfaire à force de manquer de chair. D’où le roman, la nécessité d’en revenir au concret, à la figure. Mais à l’inverse, quand j’ai terminé un roman, et comme il est rare que j’ai idée d’en commencer un autre aussitôt, je suis très heureux de trouver ce réconfort, presque lascif si vous voulez, dans cette écriture plus ouverte, moins contrainte, que propose pour moi l’état réflexif. Je devrais dire l’état pensif.
Peut-on lire, selon vous, Icebergs comme le texte où vous vous livrez le plus mais dites « Je » non pour livrer votre autobiographie mais l’autobiographie de votre écriture ? Comme si votre écriture racontait ce qu’elle fait quand elle n’est pas à l’œuvre ? Est-ce que finalement l’écriture n’est pas l’ennemie de l’œuvre ? Est-ce que le danger de tout écrivain n’est-il pas, contrairement à ce que pensait Barthes, de découvrir malgré soi que l’écriture est puissamment intransitive et qu’il s’agit, pour faire œuvre, de trouer cette intransitivité ?
Autobiographie de l’écriture, c’est exactement ça. Ce qui court entre, dessous, à côté de l’œuvre, à la fois le terreau mais aussi les mauvaises herbes…. Dans ce sens-là, l’écriture correspond beaucoup plus, en effet, au spectre dévorant de la pensée qu’à l’œuvre aboutie. Il est même probable qu’elle flirte alors plutôt avec la folie qu’avec l’œuvre. Elle a même à voir avec un certain narcissisme abyssal, un sentiment océanique de soi-même, et qui est le contraire exactement de l’œuvre. En ce sens-là, il faut se méfier de l’écriture, c’est une sirène.
Voilà bientôt plus de vingt ans que votre œuvre a débuté, et ce qui ne manque pas de frapper votre lecteur, c’est peut-être, à l’image de la nature inquiète que vous dépeignez dans Icebergs, la réticence sinon la prudence qui a toujours été la vôtre à vous saisir d’une parole pleinement théorique. Vous qui êtes hanté, comme vous le rappelez, par le démon de la citation, ne faut-il pas voir dans votre réticence le souvenir de la remarque de Proust, « notre Proust » comme vous l’appelez selon laquelle « une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix » ? Est-ce que votre réticence naît de cette réflexion proustienne qui, paradoxe ultime, est au cœur du Temps retrouvé, son récit le plus théorique ? Comment pour Icebergs avez-vous résolu cette contradiction ?
Il y a une autre phrase de Proust qui m’a hanté plus encore, celle qui ouvre le Contre Sainte-Beuve : « Chaque jour j’attache moins de prix à mon intelligence ». C’est seulement en oubliant cette phrase que je pouvais commencer Icebergs, en me disant : puisque tu es si encombré par cette « intelligence », eh bien, au contraire, il faut l’assumer, il faut même t’en débarrasser sur le papier. C’est aussi ça écrire, se débarrasser de sa pensée. Et puis je me suis rendu compte qu’en dégageant un terrain uniquement pour ça, en isolant d’une certaine manière toute cette vie intellectuelle ou savante, elle rendait plus libre encore le territoire du roman. En un sens, en faisant Icebergs, j’ai accepté d’être deux : oiseau et ornithologue, comme on dit.
On vient de parler de votre attirance mais aussi de votre réticence à la théorie qui, dans Icebergs, se voit pour la première fois vaincue dans votre œuvre mais peut-on parler aussi clairement d’essai ? Vous dites sans attendre dans votre propos introductif qu’Icebergs est un « presque-livre », qu’il ne s’agit en rien d’un « vrai livre », dites-vous encore. Que faut-il entendre par cette forte formule ? S’agit-il ici de rendre incidemment hommage à la formule de Bartleby qui « préfère ne pas », à savoir faire presque un livre et puis ne pas tout à fait le faire ? En seriez-vous d’accord ?
C’est toujours à cause de cette idée que je me fais d’un vrai livre : un moment d’incarnation véritable, où le langage crée un monde à part entière et le structure de bout en bout. Un vrai livre, c’est solide, c’est résistant. Même A la recherche du temps perdu, sous couvert d’être un peu liquide, c’est plein d’étais et d’armatures très robustes. Alors en me lançant dans le genre de l’essai et peut-être plus encore de la divagation, j’avais le sentiment d’abandonner ça : l’obsession du solide et de la composition. Je crois que c’est ce que j’essaie d’expliquer à propos de Montaigne, sa nonchalance, son laisser-aller. Montaigne prend vraiment le risque de ne pas faire un vrai livre. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas une œuvre. On peut faire une œuvre littéraire sans faire de vrais livres. Regardez Valéry.
Diriez-vous ainsi qu’Icebergs explore non la création mais le moment, terrible, de décréation ? On pourrait alors croire que ce moment s’oppose à la joie d’écrire un roman, de trouver l’œuvre, mais vous évoquez votre « conception tragique » du roman : pouvez-vous revenir sur cette forte formule ?
Tragique, ça ne veut pas dire triste. Ça veut plutôt dire : une certaine manière de capturer la tristesse. Une manière tendue, électrique, compressée. C’est dans ces termes que j’ai l’impression de penser le roman et d’en fabriquer quelquefois. En donnant figure à tout ce manque, tout ce vide, toute cette mélancolie qui peut tournoyer autour de nous. Il y a cette phrase dans Mauvais sang de Carax où la fille dit « Vite, avant que la mélancolie s’empare de tout ». Eh bien, ce pourrait être une bonne définition du roman tragique. Forcément ça fait des livres courts, très anguleux, très nerveux aussi.
Vous lisant, on pense souvent à ce que Giorgio Agamben, dans Idée de la prose, dit de l’étude, pensant notamment encore ici à Bartleby : « La tristesse du lettré : rien n’est plus amer qu’un séjour prolongé dans la puissance ». Est-ce, à votre sens, la question que se pose le narrateur d’Icebergs ?
Ah oui, c’est une formule parfaite. La puissance sans l’œuvre, oui, c’est terrible. En revanche, pour moi, la tristesse de la puissance pure, c’est vraiment la pensée intérieure, la pensée allongée sur un lit à fumer des clopes. A l’inverse, même le copiste a une œuvre. Recopier des citations toute sa vie, c’est une manière comme une autre de s’en sortir. C’est même peut-être la plus sage.
Un des personnages majeurs, dont la présence hante l’ensemble du livre, est la bibliothèque. Éclatée, répandue au sol ou au pied du lit, la bibliothèque devient une figure double, intimidante et stimulante, à l’instar de ce qu’Aby Warburg a dû éprouver à son contact. Diriez-vous ici que la bibliothèque agit sur vous à la fois comme une page noire infranchissable et la promesse d’une page blanche toujours possible ?
Oui, les deux. La bibliothèque peut quelquefois vous écraser, vous empêcher d’avancer, mais c’est aussi le modèle et le guide, par quoi vous pourrez peut-être quitter votre petite crypte. Dans tous les cas, elle est le dehors, elle est la vie des formes. Et c’est elle qui vous en donnera une, de forme. C’est exactement comme le surmoi en psychanalyse : on s’en plaint tout le temps mais si on n’en avait pas, on resterait sans doute à l’état larvaire.
Enfin, ma dernière question voudrait porter sur le « presque » manifeste de la dernière partie « Défense du négatif ». Vous y déployez une vision anti-héroïque de la littérature contemporaine, une posture modeste et feutrée qui appelle à ne pas oublier Blanchot, à ne pas en renier l’héritage. En quoi vous paraît-il important de défendre le négatif et œuvrer à une vision de la littérature où les auteurs ne sont pas des aboyeurs publics et médiatiques et d’ainsi mettre fin, dites-vous à l’instar de Serge Daney au sujet de la cinéphilie, au « concours cauchemardesque de virilité adolescente » ?
C’est sans doute d’abord une histoire personnelle, une affaire de psychologie : celle de ne pas me sentir le chantre de quoi que ce soit, celle de ne pas me sentir à l’aise avec « ceux qui ont quelque chose à dire ». Pour ma part, je continue à penser que je n’ai rien à dire. Mais ce « rien » est un territoire à part entière : celui de ma liberté, de ma souveraineté, de mon droit à la contemplation. C’est peut-être cela que j’appelle le négatif. Et c’est un territoire beaucoup plus coloré qu’il n’y paraît. Mais il y a des époques où la demande de sens est telle qu’on voudrait que même la littérature y réponde ici et maintenant. Qu’elle ajoute un discours au monde, qu’elle soit positive. Beaucoup d’écrivains eux-mêmes y trouvent leur compte et leur légitimation immédiate. Quant à moi j’ai toujours peur qu’ils étouffent l’autre parole, celle profondément insoumise, celle qui ne saurait trouver d’autre sens que le déploiement de sa propre création. Et je gage volontiers que cette parole-là, négative donc, à proportion de sa liberté grande, saura bien aussi faire trembler les lignes du réel.
entretien réalisé par Johan Faerber pour Diacritik



 Je crois qu’il est surtout né d’une accumulation de pensées que je consignais depuis plusieurs années, de manière de plus en plus quotidienne et compulsive. Alors, comme ça commençait à déborder, j’ai senti qu’il fallait les mettre en forme avant qu’il ne soit trop tard, je veux dire, avant que la tâche soit trop lourde. J’en ai parlé à un ami qui s’occupe de résidences à CICLIC, l’agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en Centre-Val de Loire, et ensemble nous avons proposé à la librairie Les Temps modernes cette idée de présentation en feuilleton mensuel. C’était d’abord un moyen de m’obliger à rédiger, à mettre en ordre ces réflexions un peu tous azimuts sur l’écriture, la pensée, l’existence, etc. Et ça a marché.
Je crois qu’il est surtout né d’une accumulation de pensées que je consignais depuis plusieurs années, de manière de plus en plus quotidienne et compulsive. Alors, comme ça commençait à déborder, j’ai senti qu’il fallait les mettre en forme avant qu’il ne soit trop tard, je veux dire, avant que la tâche soit trop lourde. J’en ai parlé à un ami qui s’occupe de résidences à CICLIC, l’agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en Centre-Val de Loire, et ensemble nous avons proposé à la librairie Les Temps modernes cette idée de présentation en feuilleton mensuel. C’était d’abord un moyen de m’obliger à rédiger, à mettre en ordre ces réflexions un peu tous azimuts sur l’écriture, la pensée, l’existence, etc. Et ça a marché.