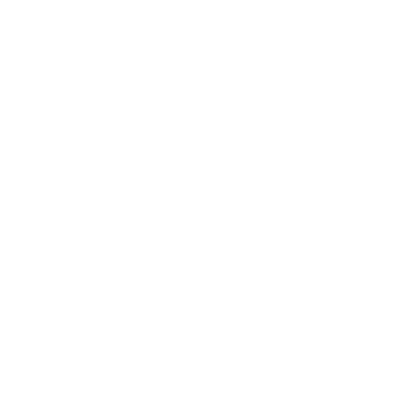En mai 2021, la troisième étape de la résidence itinérante de Thomas Giraud le mène au musée Marguerite Audoux, à Sainte-Montaigne (18). Trois jours pendant lesquels il découvre de manière privilégiée les lieux où vécut la bergère orpheline au destin étonnant, autrice entre autres de Marie-Claire (Prix Femina en 1910). En attendant la rencontre prévue dans les lieux en avril 2022 pendant laquelle l'auteur proposera un temps de restitution de sa création, Ciclic vous dévoile dès maintenant ce beau texte, Ce que regarde la mer, dans lequel Thomas Giraud invente un moment possible de la vie de Marguerite Audoux : la rencontre avec la mer, en amicale compagnie.
Au printemps 2021, l’auteur Thomas Giraud a parcouru la région Centre-Val de Loire, dans des lieux associés à quatre figures du patrimoine littéraire : le Musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine (18), le Musée Balzac – Château de Saché (37), la Maison-école du Grand Meaulnes et la Maison natale d’Alain-Fournier (18), ainsi que l'Association des amis de Michèle Desbordes (45). Chacune de ces courtes résidences a suscité l'écriture d'un texte, qui fait l'objet d'une restitution par l'auteur, dans chacun des lieux. Rendez-vous le 16 octobre à Orléans pour Descendre la Loire, autour de Michèle Desbordes, et le 17 octobre au Musée Balzac – Château de Saché (37) pour un temps de partage de son texte L'avis du couturier Jean. Les rencontres au Musée Marguerite Audoux et à la Maison-école du Grand Meaulnes auront lieu en avril 2022. Quatre univers, tels qu’il se les imagine, quatre courtes fictions, à retrouver sur le site livre.ciclic.fr. Un projet soutenu par le réseau Écrivains au Centre et Ciclic-Centre Val de Loire.
Ce que regarde la mer
Ils sont partis tôt ce matin, en train, de Paris, Charles-Louis, les deux Léon, les deux Francis, Marguerite, Claire et Albanie. Ils ont pris peu de bagages, ce sera un voyage bref, une journée et une nuit sur place et ils repartiront le lendemain. Tout a été décidé au débotté, la veille au soir, quand Marguerite a dit qu’elle n’avait jamais vu l’océan. Dans le grand désordre de cette soirée animée, dans les avancées de la nuit, après l’incrédulité des uns et des autres quant à l’affirmation de Marguerite, après des verres et d’autres verres bus encore, ils lui ont parlé des grands mouvements des vagues, du bruit insolent des mouettes, de celui tout mélangé que fait le roulis en attrapant sable, galets et poissons et même parfois un peu de ciel. Ils lui ont dit comment les embruns font les lèvres sèches et salées, comme c’est doux de se baigner sous la pluie, de mêler l’eau douce à l’eau de mer, et de nager dans la nuit noire ou éclairée par les étoiles, après minuit. Ils ont décidé qu’ils iraient au bord de la mer, très vite, tous ensemble. Pour fêter cette joyeuse décision de nouvelles bouteilles furent ouvertes.
Puis, la soirée avançant, c’est devenu plus obscur, plus obscur encore serait plus juste, tant Marguerite peinait, depuis le début, à suivre le fil de cette conversation où chacun y allait de ses expériences personnelles ; l’ivresse aidant peut-être, chacun s’était mis à sauter d’une évocation à une autre sans que ne soit jamais pris le temps de décrire les détails de ce monde marin, inconnu et opaque pour Marguerite. Que pouvait-elle imaginer des chevelures d’algues ou de la pellicule poisseuse de mer laissée sur la peau, des courses gagnées sur l’écume. Un des Léon a évoqué ce qu’il aimait le plus au bord de la mer : la polyphonie et les grandes formes. La discussion est partie sur La mer de Debussy avec ceux qui trouvaient que c’était réaliste en diable et ceux qui supposaient que Debussy, comme Marguerite, n’avait jamais mis les pieds sur une plage et qu’il y mettait trop de subterfuges pour que ça puisse être vrai. Un des Francis tentait de faire des typologies des bleus et des verts que l’on observe entre Saint-Malo et Dinard en apportant des nuances qu’il nommait neptuniennes à la Nomenclature des couleurs de Syme et Werner. Il y était question de bleus avec des pointes de citron, de verts amazoniens aux songes minéraux. Plus personne ne comprenait mais ce n’était pas l’important. Ce qui comptait c’est qu’ils iraient voir la mer.
Avec tout ça, au moment de se quitter, au petit matin, dans le reste de toutes les brumes de la nuit mêlées à celle fraiche du matin, Claire décida que l’on se donnerait un jour pour se préparer, que l’on irait le lendemain à la gare d’Orsay et qu’on prendrait avec armes et bagages le premier train qui les rapprocherait de la mer. Ils s’étaient tous promis de ne pas regarder les horaires des trains et de laisser le soin au hasard de décider pour eux.
Ils prirent le train pour Nantes et maintenant, dans l’autocar pour Pornic, ils sont tous assis, occupant plusieurs banquettes dans des états inégaux de fatigue et de courbatures. Les hommes, en dehors de Charles-Louis, font beaucoup de bruit, rient fort, commentent tout ce qui se passe ou au contraire peuplent ce qui n’appelle pas de commentaires par des plaisanteries. C’est toujours comme ça quand la bande est ensemble, à l’air libre en quelque sorte. Marguerite écoute distraitement. Elle attend que l’autocar démarre. L’attente fait partie du mouvement, pense-t-elle, et d’ailleurs, elle se sent déjà en route et proche de l’océan ; elle s’impatiente, ressent de petits picotements le long de ses bras. Elle se surprend à passer sa langue sur ses lèvres pour voir si la salure de l’océan est venue jusqu’ici, ce qui serait le signe qu’ils sont sur le point d’arriver. Elle se surprend à murmurer silencieusement, pour sa bouche, pour sa tête, pour elle-même, sans autre raison que de vérifier quelque chose qui ne peut advenir, l’océan, l’océan, l’océan. Car que peut-il advenir d’un mot psalmodié, enroulé beaucoup dans la bouche dont on a beau aimer les trois syllabes mais qui reste un mot sans signification, creux, vide, puisqu'on ne lui associe aucune image à part peut-être un peu de bleu.
Dans l’autocar, au départ rassemblée sur elle-même, rivée à la fenêtre, à moitié endormie, à moitié sans défense, elle regarde ce qui défile mollement, ce que le paysage fabrique, ce qu’il prépare, ici et là, en amont de la mer ; elle s’interroge silencieusement : est-ce que les vents portés par les vagues vont jusque dans les terres pour coiffer les arbres, les collines et les pierres d’une certaine façon ? Est-ce que la végétation est recouverte d’une petite pellicule de sel ? Pourquoi et jusqu’où l’océan s’arrête ? Et s’arrête-t-il toujours au même endroit ? Elle détaille ce qui se modifie dehors, sous ses yeux, au fur et à mesure, et à voix haute, exagère sa surprise pour jouer le rôle que ses amis, au fond, attendent d’elle, qu’ils ne puissent être déçus par un enthousiasme tiède. La forme des toits, la robe des vaches, les murs en pierre, le bleu lavé du ciel, tout y passe dans cette joie qu’elle mime pour eux et peut-être aussi pour elle, pour se donner une contenance.
Ceux qui ne somnolent pas rient avec elle de ses commentaires. Un des Francis dit qu’on est debout depuis longtemps et que les voyages creusent, et qu’il faut manger. Charles-Louis se moque de cette phrase à la causalité boiteuse et déclame tout à coup, après avoir ébouriffé la tête de Francis, que le monde est divisé en deux, ceux qui se coiffent et les autres, et que certains sont plus malins que d’autres. On déballe les victuailles des paniers et l’habitacle de l’autocar s’emplit d’un capharnaüm d’odeurs dont l’œuf dur, un morceau de brie et quelques salaisons tirent leur épingle du jeu. Marguerite ne mange pas, la perspective de voir l’océan aimante tout.
Elle ne dit pas la mer mais toujours l’océan. Peut-être qu’il lui est difficile de s’approprier ce mot, mer, et donc rendu difficile à prononcer ; c’est étriqué, court, plein de manques, inachevé, alors qu’océan ouvre sans fin et donne l’impression de rejoindre les mondes. Peut-être que c’est sans raison, par une habitude prise sans qu’on l’ait vu venir, comme ceux qui préfèrent dire habits que vêtements.
Puis l’autocar s’arrête. Sous ses pneus, quelques crissements qui rappellent des gâteaux secs écrasés. On descend à tour de rôle sur la petite place d’où partent trois rues, dont deux donnent sur la mer. Marguerite sent immédiatement dans l’air aspiré une rugosité, quelque chose qui gratte la gorge, puis le vent qui entre dans ses narines, peut-être même dans ses oreilles. Elle est étourdie. Elle suit le mouvement du groupe qui prend la première rue qui mène à la mer. Albanie et les deux Léon sont restés derrière Marguerite, les autres avancent d’un bon pas, devant, un des Francis loin devant a commencé à ôter une partie de ses habits en marchant. Par pudeur, pour ne rien lui voler, pour la laisser découvrir et apprécier seule la raison du voyage, cet endroit où la chaussée commence à se recouvrir de sable, à ne plus être que du sable, personne ne dit rien.
Elle s’arrête de marcher. Il y a d’abord un moment de sidération, devant cet océan, cette drôle de chose, liquide, qui bouge partout, tout le temps, fatigue les yeux. La mer qui attrape le soleil et vous l’envoie dans la figure. Il faut s’habituer. S’habituer aussi à cette façon que les nuages ont de donner l’impression de sortir de mer, à l’horizon. Elle n’en est pas encore à se faire une idée mais elle prend conscience de ce qui est là. Et puis elle apprivoise ou se laisse apprivoiser par le mouvement des vagues, ce qu’il fait aux yeux et au cœur même lorsque l’on a les deux pieds sur la terre ferme. Une fois que tout est bien installé, Marguerite sent qu’il lui faut dire quelque chose. Tout le monde se tait, les compagnons de voyage, le sable, le vent, le ciel, la mer aussi. Un intervalle de silence où traine l’écho de ce qui précédait et où tout semble prendre une grande inspiration, comme pour un moment très important ou comme les deux secondes qui précèdent l’instant où ta bouilloire va se mettre à siffler sous le coup de toute la vapeur dégagée par l’eau qui bout.
Elle ne dit toujours rien. L’océan semble être un ensemble total, le dessus, le dessous, ce qu’il y a derrière et l’horizon sans fin, véritablement, qui est encore l’océan. Un lieu à part où les voix portent sur l’eau, où les oiseaux vont et viennent, où elle devine les vibrations lumineuses du ciel.
Marguerite a l’impression que la mer la regarde. Pas des grands yeux interrogatifs ou curieux qui seraient de toute façon impossibles à placer sur tout ce bleu mouvementé, mais par cette lumière qui semble venir de l’intérieur et qui apporte cet aspect translucide. Cette immensité la jauge, palpe si d’une certaine façon Marguerite pourrait être emportée par un sentiment océanique. La mer se demande ce que Marguerite va faire. Partir, parler, mettre ses pieds dedans, au milieu de tous les souvenirs accumulés, avalés par la mer depuis des milliers d’années ?
Curieusement, alors que la mer ouvre le paysage, le vide de tout, se contente de rien, d’un minimalisme de bon aloi, des lignes jaunes, des lignes bleues et entre les deux le blanc mousseux de l’écume, Marguerite pense à la Sologne, à tous ces arbres, à la ligne qu’ils font, à leur grand mouvement dans les airs.
Alors qu’Albanie et Charles eurent l’impression que Marguerite murmurait merci, l’attention de tous fut prise par les grands gestes et les éclats de rire que Francis faisait dans l’eau avec les deux Léon.
[Thomas Giraud, 2021]